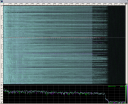La façon la plus simple de configurer son réseau est sans contexte d’utiliser le Network Manager. Network Manager est une applet Gnome se trouvant dans la zone de notification de la barre des tâches. Il n’empêche qu’il peut être intéressant par curiosité intellectuelle ou parce que vous vous trouvez face à une machine équipée de Ubuntu Server, de savoir dans quels fichiers se trouvent les paramètres du réseau et quel outils utiliser pour le configurer à la main à partir d’un terminal.
La première commande à connaître est ifconfig. Cette commande vous donne la configuration actuelle (pour autant que le réseau soit configuré) de votre réseau.
$ ifconfig eth0
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:0E:A6:6C:10:D9
inet adr:192.168.8.3 Bcast:192.168.8.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::20e:a6ff:fe6c:10d9/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:64680 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:54728 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:79475594 (75.7 MB) Octets transmis:6773621 (6.4 MB)
Interruption:19
La ligne intéressante est:
inet adr:192.168.8.3 Bcast:192.168.8.255 Masque:255.255.255.0
qui vous dit que l’interface eth0 a comme adresse réseau 192.168.8.3 et comme masque 255.255.255.0. C’est l’adresse actuelle de mon PC. Mais d’où sort cette adresse, où est-elle stockée?
Il y a deux fichiers de configuration importants contenant les informations du réseau et qu’Ubuntu lit au démarrage de la machine pour configurer le réseau. Il s’agit de /etc/network/interfaces, et de /etc/resolv.conf.
Le premier fichier /etc/network/interfaces contient la configuration de chaque interface de votre PC. Dans mon cas, il contient ceci:
$ more /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.8.3
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.8.1
auto eth1
#iface eth1 inet dhcp
auto eth2
#iface eth2 inet dhcp
auto ath0
#iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
On voit que l’interface réseau eth0 est configurée et que son adresse IP est 192.168.8.3, son masque 255.255.255.0 et que le gateway (passerelle) est 192.168.8.1. C’est l’adresse de mon routeur ADSL.
A noter aussi que les autres interfaces non utilisées sont, par défaut, configurée pour travailler en DHCP.
Le fichier /etc/resolv.conf contient l’adresse IP des serveurs DNS utilisés lorsque s’établit une connexion à Internet. Par exemple, voilà pour mon PC au boulot, ce qu’il contient:
$ more /etc/resolv.conf
nameserver 172.17.10.3
search mon_domaine.com
nameserver 172.17.20.3
On retrouve les deux adresses des DNS primaire et secondaire mais également le suffixe de domaine (domaine de recherche) à ajouter pour former une adresse complète.
Configurer son réseau à la main
Pour modifier la configuration de votre interface réseau depuis un terminal, il suffit d’abord de désactiver l’interface réseau:
$ sudo ifdown eth0
Ensuite, éditer les fichiers /etc/network/interfaces et /etc/resolv.conf pour y mettre les paramètres que vous désirez:
$ sudo gedit /etc/network/interfaces /etc/resolv.conf
Terminez en réactivant l’interface réseau:
$ sudo ifup eth0
C’est tout. Néanmoins, cela demande quand même pas mal d’opérations et il faut que gedit soit installé et donc Gnome. Dans le cas d’une version serveur d’Ubuntu, ce n’est pas le cas. De plus, ifdown et ifup font appel à ifconfig et route pour reconfigurer le réseau. Pourquoi donc ne pas utiliser directement ifconfig alors? Voilà comment reconfigurer une interface au moyen de ifconfig et route:
D’abord désactiver l’interface:
$ sudo ifconfig eth0 inet down
Ensuite, la configurer et la réactiver en une seule commande:
$ sudo ifconfig eth0 inet up 192.168.8.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.8.255
Ajouter le gateway en créant une route:
$ sudo route add default gw 192.168.8.1
Editez /etc/resolv.conf en utilisant nano par exemple et votre interface sera configurée:
$ sudo nano /etc/resolv.conf
Vous avez maintenant en main tout ce qu’il faut pour configurer votre carte réseau sans devoir vous servir de Network Manager. Ca n’est pas plus simple mais au moins vous comprenez maintenant comment ce programme s’y prend.